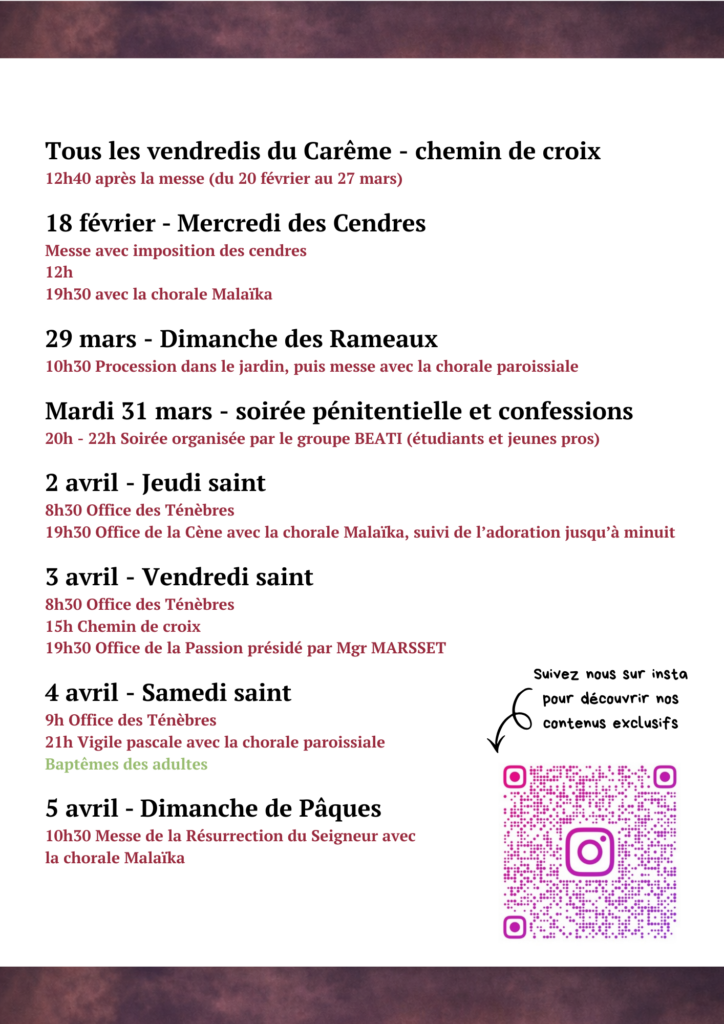Au cœur des Grandes Carrières
Les habitants du quartier, les paroissiens et le Père François d’Aigremont vous proposent la newsletter de l’été sur l’histoire de notre paroisse, Sainte Geneviève des Grandes Carrières et des Œuvres de Championnet, à lire au bord de la piscine, dans le train ou sur la plage. N’hésitez pas à réagir et à partager vos souvenirs…
Un chapitre est envoyé une fois par semaine le mercredi jusqu’à la fin de l’été à la place de l’Écho, notre fiche d’information paroissiale. Si vous voulez recevoir les prochains chapitres par e-mail, veuillez contacter le secrétariat – paroisse@sgdgc.fr / 01 53 06 65 39
Chapitre 1 : le jardin aux ronces (1888)
Chapitre 2 : Le jardin interdit et la chapelle de secours (1888 – 1891)
Chapitre 3 : L’élan des œuvres (1891–1905)
Chapitre 4 : La naissance d’une paroisse (1905 – 1907)
Chapitre 5 : Quand le sang d’un prêtre scelle l’histoire d’une paroisse (1908 – 1914)
Chapitre 6 : Quand le fracas du monde s’abat sur Championnet (1914 – 1918)
Chapitre 7 : Quand les morts veillent, la jeunesse reprend la flamme (1918–1930)
Chapitre 1 : le jardin aux ronces (1888)
Dans la poussière des carrières
Au cœur du tout jeune quartier des Grandes‑Carrières, les carrières de gypse et les ateliers de meules s’entremêlaient aux ruelles étroites. On appelait cette ceinture ouvrière la « Chine qui entoure Paris », tant la pauvreté y régnait loin des fastes de l’ancienne capitale. Les maisons de pierre, parfois criblées d’impacts datant de la Commune de 1871, laissaient filtrer un froid humide. Les familles s’entassaient dans des « garnis », petits logements meublés et très sommaires, dépourvus d’eau courante et d’air pur, les enfants couraient parmi les gravats, et nul lieu ne leur offrait un havre de chaleur ou de joie.
La mission confiée à l’Abbé Deleuze
Dans ce décor de misère et de souvenirs révoltés, l’archevêque de Paris décida, en coulisses, d’instruire un dossier secret : il souhaitait qu’une chapelle de secours et un patronage voient le jour pour ces habitants isolés. Le dossier, soigneusement monté, fut remis à l’abbé Albert‑Jean Deleuze, jeune vicaire à Saint‑Michel‑des‑Batignolles. Sans grande publicité, Deleuze reçut instruction de dégager un terrain propice à la prière et à l’entraide ; l’Église, fragilisée par les lois laïques, ne souhaitait pas d’appel public, mais un simple acte de solidarité concrète.
À la recherche du jardin
Dès les premiers jours de l’année 1888, Deleuze explora chaque lopin abandonné : un pré à flanc de butte trop incliné pour des jeux d’enfants, une friche près d’anciennes fortifications jugée insalubre… Puis, au détour de plans cadastraux, il tomba sur le nom Ruggieri. Un ancien domaine d’artificier, situé à l’angle de la rue Championnet et de la rue des Poissonniers, portait encore les stigmates des poudrières abandonnées. Il imagina aussitôt la possibilité d’un renouveau : l’histoire des Ruggieri, autrefois maîtres des fusées de fête, lui donnait un parfum de magie.
L’acte d’acquisition et le comité des 6
Avec le soutien discret d’Émile Hirsch, marchand d’étoffes de la rue Rochechouart, l’abbé put réunir les fonds nécessaires. Le 11 avril 1888, l’acte d’achat fut signé chez le notaire : ce jardin de ronces et de lilas sauvages devenait propriété de l’Église. Les habitants, surpris de voir filer sous leur nez ces murs décrépis, murmuraient que la foi, ici, s’installait contre toute attente.
À la fin du mois d’octobre, dans une cuisine enfumée du presbytère de Notre‑Dame‑de‑Clignancourt, six acteurs de ce projet se retrouvèrent : Deleuze, Hirsch, Riant, Gouin, May et Dehou. Sans cris ni fanfares, ils scellèrent un engagement : transformer ce jardin en chapelle et en lieu d’accueil pour les enfants et les familles du quartier. Leurs mains serrées, à la lueur d’une bougie, scellaient un pacte de courage.
Les premiers aménagements
Dans les semaines qui suivirent, le terrain prisait de vie : on dégagea les ronces, on retira les poutres vermoulues, on bûcha les vieux lilas. Les meubles vinrent de bric et de broc : des chaises bancales offertes par un café de la rue Championnet, trois bancs d’auberge récupérés chez un
restaurateur compatissant, deux caisses à vin retournées formèrent un autel et un pupitre. Les villageois, intrigués, se penchaient par‑dessus les palissades, repérant ces silhouettes affairées.
L’interdiction préfectorale
Mais le ministère de l’Intérieur, soucieux de ne pas multiplier les lieux de culte, publia un arrêté interdisant toute nouvelle chapelle dans ces faubourgs qualifiés de « zone de surcharge paroissiale ». Les archives mentionnent la crainte d’alourdir la charge déjà trop lourde de Notre‑Dame‑de‑Clignancourt, et la volonté d’étouffer toute initiative jugée trop indépendante.
La messe clandestine
Pourtant, un matin d’hiver 1888, alors que le givre transformait chaque lame de bois en miroir, une cinquantaine de fidèles poussèrent la grille du jardin, enveloppés de châles et de pardessus. Dans le hangar retapé, l’air vibrait de froid : les bougies tremblaient sur l’autel improvisé, projetant des ombres dansantes sur les poutres nues. Debout sur sa caisse, Deleuze ouvrit le missel et prononça les prières, sa voix calme défiant l’arrêté. Les enfants, le cœur battant, entonnèrent un chant timide, tandis que l’humidité de la terre se mêlait au souffle de la communauté.
Au moment du « Notre Père », un cliquetis se fit entendre : la grille tinta, et l’on sentit la présence d’un huissier venu notifier l’interdiction. Nul ne recula. Dans ce jardin de ronces, la foi venait de s’enraciner…
Chapitre 2 : Le jardin interdit et la chapelle de secours (1888 – 1891)
Un jardin, une messe… une interdiction
Tout avait pourtant bien commencé. Un terrain paisible avait été acquis au 172 de la rue Championnet, un bout de terre encore marqué par les lilas, les ronces et les pierres du passé. C’était un jardin modeste mais lumineux, plein de promesses. Et un matin blême de 1888, dans l’air frais et encore brumeux, une première messe y fut célébrée. Presque à voix basse. Sans clocher, sans bannière, sans orgue. Un simple autel de fortune, une poignée de fidèles grelottants, et cette certitude douce et tenace : ce quartier oublié allait, lui aussi, avoir son Évangile.
Mais à peine le pain rompu, un cliquetis de clé fit sursauter l’assemblée. Un huissier, envoyé par la Préfecture, franchit la grille. Il tenait à la main un arrêté sec, sans appel : interdiction formelle de dire la messe ou d’ériger un lieu de culte sur ce terrain. Le décret venait de Paris. La messe était dite ou plutôt, ne le serait plus. Le jardin devint muet, refermé sur sa foi suspendue.
Un évêque prudent, un diplomate inspiré
L’Église aurait pu protester, mais l’archevêque de Paris, le cardinal François-Marie-Benjamin Richard, homme avisé, connaissait les risques d’un affrontement direct avec la République. Nous étions à l’heure des grandes lois laïques, tout juste votées : laïcisation de l’école publique (1882), dissolution des congrégations non autorisées (1884), et surveillance stricte des lieux de culte. Chaque pierre bénie faisait trembler les ministères. Chaque messe non déclarée devenait affaire d’État.
Fallait-il renoncer ? Non. Mais contourner l’obstacle, oui.
Et c’est là qu’apparut un allié inattendu : le consul général des Pays-Bas à Paris, Monsieur Van Lier. Diplomate habile, homme de cœur et de réseaux, Van Lier n’était pas seulement le représentant du royaume néerlandais. C’était aussi un chrétien engagé, attentif à la condition des ressortissants hollandais malades ou isolés dans la capitale.
Avec finesse, il proposa une ruse légale : créer un hôpital néerlandais, porté par une société de bienfaisance à vocation diplomatique, et y adjoindre une chapelle privée, réservée aux patients et au personnel. L’ensemble, relevant du droit international et des usages consulaires, ne dépendait pas du ministère des Cultes. L’administration française, bien embarrassée, ne pouvait s’y opposer sans risquer un incident diplomatique. Le projet fut donc toléré à contrecœur.
Sous couvert de charité étrangère, c’était bien une œuvre pastorale qui s’implantait. Et l’Église venait de reprendre pied dans ce coin du nord parisien, sans croiser le fer.
Une vente sous conditions éternelles
Restait à transmettre le terrain. L’homme providentiel s’appelait Émile Hirsch. Propriétaire de l’ancien hôtel Ruggieri voisin, philanthrope discret, il proposa un geste de foi : il céderait la parcelle à l’Église pour une somme symbolique, à une condition : que quatre messes soient célébrées à perpétuité pour le repos de son âme et de sa famille. Ce don, humble en apparence, liait à jamais le sol à la prière.
Le chantier discret d’une chapelle légale
Autour de Hirsch, un petit comité se forma : Riant, May, Dehou, Collard, des noms modestes, mais des cœurs actifs. L’architecte Coulomb dessina une chapelle sans éclat, mais robuste, de style Renaissance, à construire par tranches selon les moyens. Les matériaux étaient simples, les ambitions grandes.
Pendant que les murs montaient, les Sœurs Augustines de l’Hôtel-Dieu s’installèrent. Officiellement, elles venaient soigner les malades. Officieusement, elles bénissaient chaque pierre du chantier, chaque clou, chaque geste. Le sacré circulait sans bruit.
Dans l’ombre encore, l’abbé Deleuze, alors séminariste, reçut du vicaire général une mission : être le chapelain des lieux, et du bastion militaire voisin. Il n’était pas encore prêtre, il ne le serait qu’en décembre 1891) mais déjà, l’Église le considérait comme tel. La fonction précédait la consécration.
La première messe officielle
Le 19 mai 1891, la chapelle du 172 ouvrit enfin ses portes. Pour l’occasion, tout avait été prêté : des chaises de Notre-Dame de Clignancourt, des ornements liturgiques de Saint-Michel, un ostensoir par un bronzier compatissant. Le compositeur Dupaigne composa une messe inédite. Et Hirsch, toujours en retrait, fit installer une verrière monumentale, sauvée de l’Exposition universelle.
Deleuze, encore diacre, assista sans présider. Un prêtre ami célébra. Mais dans l’esprit de tous, c’était sa chapelle. Son combat. Son troupeau. Et les fidèles, venus nombreux malgré l’interdiction d’affichage, chantèrent avec ferveur non pas pour défier la République, mais pour dire qu’ici, à Championnet, on avait soif de Dieu.
Et déjà… les Œuvres germent
Ce jour-là, les Œuvres de Championnet prirent racine. Il n’y avait pas encore de patronage, ni d’école, ni même de scouts. Mais il y avait un jardin, une chapelle, quelques bancs, quelques enfants, et des visages tournés vers l’avenir. Le reste allait suivre.
Chapitre 3 : L’élan des œuvres (1891–1905)
Un quartier en devenir
Le nom du quartier, les Grandes Carrières, vient de là : des galeries de gypse couraient jadis sous la butte Montmartre. Ce plâtre, blanc et fin, a bâti les murs de Paris. Longtemps extraites, ces carrières ont fini par laisser derrière elles un sol instable, peu propice aux grands immeubles, mais parfait pour un entrelacs de maisons basses, de talus, de sentiers boueux et d’ateliers. C’est ainsi qu’un quartier s’est dessiné, un peu en marge, un peu oublié. On l’appelait le Champ-Marie. Et dans ce coin en devenir, les enfants étaient partout.
Un projet né d’un vide
Ce que voulait l’abbé Albert Deleuze, ce n’était pas seulement une chapelle. Il voulait un lieu pour les enfants du quartier. Un endroit pour apprendre, pour jouer, pour grandir autrement. Un patronage. À l’époque, ce mot désigne une maison de quartier fondée par l’Église, mais ouverte à tous : on y propose des jeux, des cours, du théâtre, un coin chaud l’hiver, un toit l’été. Et surtout, une présence bienveillante. Ce n’est pas encore une paroisse, encore moins une institution. C’est une main tendue, dans un quartier où les écoles laïques sont rares, les loisirs inexistants, et la pauvreté omniprésente.
Les premières classes et un nouvel allié
En 1891, une première salle accueille des fillettes. Les moyens sont dérisoires : quelques bancs, un tableau, des cahiers à moitié usés. L’argent vient de dons dispersés, réunis par Deleuze et ses proches. Il faut convaincre, encore et encore. En 1892, les garçons ont leur propre salle.
Et la même année, l’abbé Henry Garnier, tout juste ordonné prêtre, vient prêter main forte. Il devient directeur de l’école. Ensemble, Garnier et Deleuze parcourent chaque ruelle, visitent les familles les plus modestes, y compris les chiffonniers nombreux dans les abords du Champ-Marie. Garnier assure aussi l’aumônerie de l’hôpital Bichat. Mais le rythme l’épuise. En 1896, il cède sa place pour un temps, rejoint la paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois. Il y soigne sa santé, et revient en 1898, plus solide encore.
Un quartier en pleine mutation
La rue Championnet trace déjà sa ligne droite, mais la rue Belliard s’interrompt encore au niveau du maquis. Le quartier se bâtit à coups de permis de construire improvisés, de maisons de fortune, d’ateliers en tôle. Pourtant, ici, au 174, une œuvre prend racine. Une œuvre pensée, portée, et désormais soutenue.
Une bienfaitrice dans l’ombre
Le 26 juin 1899, une page se tourne. Marguerite Lebaudy, riche héritière du boulevard Haussmann, remet un don colossal : 57 658 francs. Elle ne souhaite ni plaque, ni vitrail, ni publicité. Elle exige même que son geste reste discret. Sa seule condition : qu’on construise. Grâce à elle, les écoles s’agrandissent. Une salle d’asile voit le jour pour accueillir les plus petits. La cour est nivelée. Une salle portera le nom de sainte Marguerite, et deux places y seront
toujours réservées pour des enfants sans ressources. Ce don silencieux donne à l’œuvre sa force et sa stabilité.
Une ruche d’enfants
En octobre 1900, quatre nouvelles classes ouvrent, et l’œuvre peut accueillir jusqu’à 250 élèves. À la fin de l’année, près de 1 000 enfants fréquentent les lieux chaque semaine. En mai 1901, on fête les dix ans des œuvres : 1 574 premières communions, 1 156 baptêmes, 374 mariages régularisés, des milliers d’aides, de repas, de visites. Le patronage est devenu un refuge. Une maison où l’on apprend, où l’on mange, où l’on s’élève.
Un journal pour dire la vie
Depuis 1894, L’Écho de Championnet raconte tout cela. Imprimé à petit tirage, vendu cinq centimes, il annonce les fêtes, les retraites, les grands jeux. Il dit aussi les joies simples, les départs en colonie, les petites réussites. Il circule de main en main, parfois jusque dans les faubourgs de Clichy.
Un métier entre les mains
En octobre 1901, l’école des mécaniciens ouvre. Deux ans d’apprentissage, un diplôme en poche, parfois une demi-bourse pour continuer aux Arts et Métiers de Lille. Le patronage ne s’arrête pas à l’enfance : il accompagne les grands jusqu’à la vie active.
L’hôpital ferme, les soins continuent
En 1905, l’hôpital néerlandais ferme ses portes. Conçu à l’origine pour des ressortissants étrangers, il n’a plus de raison d’être. Avec ses 28 lits, il aura soigné chaque année près d’une centaine de malades. Mais la santé reste une urgence. L’abbé Garnier propose alors à deux infirmières, la générale Voisin et la comtesse d’Arlincourt, d’ouvrir un dispensaire. Il leur cède un local pour un franc symbolique. En dix mois, elles réalisent plus de 6 000 pansements. Le cardinal Richard en personne vient bénir ce nouveau lieu de soin.
Une Église sans titre, mais bien là
La loi de séparation de 1905 interdit toute subvention aux cultes. Mais à Championnet, l’Église est là, même sans titre. Il n’y a pas encore de paroisse. Pas d’église reconnue. Ce qui existe, c’est une chapelle tolérée, des écoles vivantes, un dispensaire fréquenté. Ce n’est pas officiel, mais c’est réel. Et profondément enraciné.
Chapitre 4 : La naissance d’une paroisse (1905 – 1907)
L’hiver où tout pouvait s’effondrer
À l’automne 1905, le quartier Championnet, déjà privé de tout confort moderne, apprit que même l’espérance allait devoir se battre. La loi de séparation entre l’Église et l’État, promulguée en décembre, ne fut pas seulement une affaire de doctrine : elle déclencha un séisme social. Désormais, plus aucun prêtre ne serait payé par la République, plus aucune école libre ne serait tolérée sans conditions, plus aucun bâtiment ne serait mis à disposition des œuvres catholiques.
Mais à Championnet, rien de tout cela n’avait jamais existé. Ici, les habitants n’avaient jamais compté que sur eux-mêmes. Ils n’avaient ni église officielle ni presbytère, ni même de curé nommé. Seule une modeste chapelle, sans clocher et sans faste, s’élevait sur un terrain acheté autrefois par la Société Immobilière des Grandes Carrières, ce groupe de laïcs fondé autour de l’abbé Deleuze pour garantir un toit aux œuvres. Là, on baptisait les enfants, on accompagnait les mourants, on transmettait un peu de lumière.
Une œuvre ou la rue
Si les œuvres disparaissaient, il ne resterait plus rien. Plus de lecture pour les enfants. Plus de soins pour les blessés. Plus d’écoute pour les femmes seules. On vivait à huit dans une pièce, sans eau, sans électricité, avec l’angoisse d’un hiver qui n’en finissait pas. Le dispensaire Saint-Joseph avait soigné plus de six mille plaies en dix mois. L’école libre accueillait chaque semaine près de mille enfants. Sans statut, tout cela pouvait être interdit du jour au lendemain. Mais le quartier ne se résigna pas. Les filles, elles, suivaient des cours de couture, de lecture, de dactylographie. Les garçons, eux, apprenaient le français, l’anglais, la comptabilité, mais aussi la discipline par le sport et les jeux collectifs. Les dames adoratrices priaient chaque semaine pour la survie des œuvres. Les mères chrétiennes organisaient la soupe populaire. Les anciens élèves formaient les plus jeunes. Et tous, pauvres ou modestes, glissaient dans l’enveloppe du Denier du Culte une pièce, une prière, un espoir.
Ce combat prit la forme la plus modeste et la plus décisive : une quête dominicale. Le Denier du Culte, lancé à l’échelle nationale pour pallier la fin du financement public, fut ici vécu comme un acte de survie. Car à Championnet, l’Église qui n’existait pas officiellement n’était pas un monument à entretenir, mais une vie à défendre. Il ne s’agissait pas d’un don abstrait, mais d’un geste vital. Derrière chaque sou déposé dans la quête, il y avait une voix qui murmurait : « Pour que mes enfants aient encore un lieu où apprendre. Pour que ma vieille mère puisse encore être visitée. Pour qu’on m’enterre ici, et pas dans l’oubli. » C’était plus qu’un financement : c’était un cri de résistance.
Un acte fondateur : la paroisse est née
Depuis des mois, les habitants réclamaient une reconnaissance officielle. Car sans paroisse, pas de curé désigné. Pas de registres. Pas de certificats valides pour les baptêmes, les mariages ou les enterrements. On naissait, on se mariait, on mourait, mais rien n’était inscrit. C’était comme si ce peuple n’existait pas. Une paroisse, c’était bien plus qu’un cadre administratif : c’était une présence, une mémoire, une légitimité. C’était permettre aux familles de transmettre la foi, de
confier leurs enfants à un pasteur, de recevoir les sacrements dans un cadre reconnu, protégé, durable.
Le cardinal Richard, archevêque de Paris, suivait ce combat de près. Il connaissait le quartier. Il savait ce qui s’y vivait. Et ce qui risquait de disparaître. Le 9 février 1907, il signa l’ordonnance canonique érigeant une nouvelle paroisse à partir de territoires détachés de Notre-Dame de Clignancourt et de Saint-Michel des Batignolles. Elle porterait le nom de Sainte Geneviève de Montmartre. Mais très vite, dans les bouches et dans les cœurs, elle prit un autre nom : Sainte Geneviève des Grandes Carrières. Car c’était bien là son origine, sa mémoire, sa promesse. Et c’est encore aujourd’hui ce nom que nous portons.
Un dimanche de feu sous la pluie
Le 17 février 1907, la chapelle ne suffit pas. Plus de cinq cents personnes se pressèrent sous la pluie, sous les fenêtres, jusque dans la rue. L’abbé Garnier, déjà pasteur de fait, devint pasteur de droit. Il déroula le registre des baptêmes, posa la main sur l’autel, et un silence parcourut l’assemblée. Ce jour-là, le quartier reçut un nom. Un ancrage. Un foyer. Ce jour-là, on n’avait plus honte de vivre là.
Le souffle de l’abbé Bernard
Quelques semaines plus tard, un jeune prêtre, l’abbé Julien Bernard, fut nommé vicaire. Il apporta un élan nouveau. Il bénit les pansements du dispensaire, consola les familles, organisa les répétitions de gymnastique, participa aux veillées. Il prit la tête de Championnet Sports et structura les séances : deux cents garçons pratiquaient la gymnastique athlétique, encadrés par des anciens. Les filles, plus de cent, suivaient des ateliers de maintien, d’entraide, de confiance. Et dans chaque cri, dans chaque course, dans chaque reprise de souffle, il y avait une manière de dire : « Nous sommes là. Nous vivons. Nous grandissons. »
La loi contournée, l’avenir protégé
Mais comment préserver ce fragile édifice sans enfreindre la loi ? Comment continuer à instruire, soigner, encadrer, célébrer… sans disparaître ? Il fallait trouver un cadre. Ce fut l’idée de génie de Garnier et de Bernard. En mai 1907, ils fondèrent une association selon la loi de 1901 : Championnet Sports. L’association fut enregistrée à la préfecture, ses statuts rédigés avec soin, et son affiliation à la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France lui permit d’exister légalement, sans mention de culte. Ce cadre civil, astucieux, autorisa la poursuite des activités éducatives et sportives sans violer la loi. Et, dans le fond des salles, les catéchèses reprirent, à voix basse, comme on cache un feu fragile sous la cendre.
Et vous, que reste-t-il de cette histoire ?
Sainte Geneviève des Grandes Carrières n’a jamais cessé d’exister par la foi et la volonté de ses habitants. Elle tient encore debout, non par privilège ou legs institutionnel, mais grâce à un héritage vivant : celui des gestes offerts, des liens tissés, des visages éclairés. Contrairement aux églises érigées avant 1905, elle ne bénéficie d’aucune aide publique. Elle vit encore aujourd’hui grâce à l’engagement fidèle de ceux qui la font vivre. C’est sa singularité, sa force mais aussi sa grande fragilité.
Chapitre 5 : Quand le sang d’un prêtre scelle l’histoire d’une paroisse (1908 – 1914)
Les années d’espérance
À partir de 1907, la jeune paroisse n’était plus seulement un terrain de bonne volonté, mais un lieu reconnu, inscrit sur les registres, avec un nom que l’on pouvait prononcer fièrement. Dans les salles des œuvres, l’abbé Garnier passait d’une table à l’autre, vérifiant qu’aucun enfant ne restait à l’écart, qu’aucun malade ne manquait de visite, qu’aucune mère ne se sentait seule.
Chaque semaine s’écoulait dans ce mélange d’habitudes et d’inattendu : le catéchisme rassemblait les enfants du quartier, les filles se retrouvaient aux cours de couture ou de dactylographie, les garçons aux jeux du patronage et aux études du soir. Dans le dispensaire, on pansait les plaies et on prêtait l’oreille aux inquiétudes ; dans la grande salle, une soupe fumante réchauffait ceux que l’hiver avait mordus. Et partout circulait cette phrase qui tenait tout : « On continue ».
En 1908, la fréquentation dominicale atteignait déjà près 2000 fidèles. Les registres témoignaient d’une vitalité étonnante pour une paroisse si jeune : 269 baptêmes, 116 mariages, 200 premières communions, 267 convois religieux, et une centaine d’unions régularisées. L’école paroissiale accueillait 600 élèves répartis en neuf classes, et le patronage comptait environ 700 inscrits. 30 dames catéchistes veillaient à l’instruction religieuse, et 7 jeunes issus des œuvres se préparaient au sacerdoce.
Ces chiffres impressionnaient l’archidiacre Fages, venu en visite pastorale cette année-là. Mais il voyait aussi l’envers du décor : un budget annuel de 80 000 francs, dont plus de la moitié devait être trouvée chaque année par le curé. Garnier ne se laissait pas arrêter par cette montagne. En quinze mois, grâce à un emprunt de 94 000 francs contracté par la Société Immobilière des Grandes Carrières et à 73 000 mille francs de dons et de souscriptions, il avait financé un bas-côté, la sacristie, un orgue Cavaillé-Coll, la façade, la tribune, plusieurs salles de catéchisme, ainsi qu’un système de chauffage pour l’église.
À l’automne 1909, il restait encore de grands projets à mener : l’autre bas-côté, le clocher, le presbytère, une salle de conférences. Mais l’élan était là, solide, enraciné dans le quartier, et chacun savait qu’il ne faiblirait pas tant que Garnier tiendrait la barre.
Les pierres montent vers le ciel
Très vite, la petite chapelle, serrée entre ses murs modestes, sembla retenir son souffle. On rêva plus large. On décida d’ajouter une vraie sacristie, puis d’élever un clocher qui dirait au quartier que l’église était là pour durer. L’architecte L.-P. Chauvet traça des lignes sobres et solides, comme il savait le faire, et choisit la pierre meulière, rustique et claire, dont chaque bloc semblait avoir gardé la chaleur des carrières toutes proches. Entre 1908 et 1912, ces pierres s’empilèrent patiemment, dessinant des murs qui s’écartèrent pour laisser respirer la nef. Peu à peu, l’édifice prit allure de maison, ouverte à tous. Un matin clair, les maçons fixèrent au sommet un coq de métal, mince sentinelle tournée vers l’est. Alors, dans un même élan, les enfants levèrent le menton vers lui, comme pour dire au ciel : « Nous sommes ici. »
Le jour des cloches
Elles étaient attendues comme le Messie : avec impatience, tendresse et un peu d’angoisse pour le voyage. Fondues à la fonderie Paccard d’Annecy-le-Vieux, elles avaient traversé la France, puis chargées sur une charrette tirée par des chevaux, cahotant sur les pavés du quartier. Bien calées et entourées de paille, elles étaient couvertes d’un drap épais. On écarta le tissu, et la lumière du matin se posa sur leur métal neuf, où couraient des gravures fines : sur chacune, un décor de feuillages, quelques mots d’action de grâce, et les noms de ceux qui avaient contribué à leur naissance. On lut les inscriptions comme on lirait une page d’histoire intime, car chaque don, petit ou grand, avait laissé une trace sur ce bronze.
La plus grande reçut le nom de Geneviève, protectrice et mémoire du lieu. Sa cadette, plus légère mais non moins claire, fut baptisée Jeanne d’Arc, image de courage et d’élan. Le jour de leur bénédiction, la nef débordait : anciens, enfants, familles entières, tous venus entendre pour la première fois la voix nouvelle de l’église. Quand le battant frappa le bord de Geneviève, un son grave monta dans le ciel, profond comme un cœur qui bat. Jeanne d’Arc répondit, plus vive, plus claire, et les deux voix s’entrelacèrent dans l’air comme une promesse.
On aurait dit que la rue entière s’était figée : des marchands, paniers à la main, s’étaient arrêtés net ; les enfants, bouche ouverte, ne pensaient plus à courir ; même les chats, sur les murets, semblaient écouter. Dans ces deux notes, il y avait tout : les jours de fête où l’on se retrouve, les veilles de prière dans le silence de la nuit, les adieux où l’on serre les mains longtemps, et les recommencements qui font croire à la vie plus forte que tout.
La colonie qui ouvre l’horizon
L’été, on emmenait les enfants à Saint-Gervais, en Normandie. On partait à l’aube, encore enveloppés de fraîcheur, foulards noués et boîtes à pique-nique soigneusement alignées sur le quai. Le trajet était déjà un parfum d’aventure : on chantait, on se serrait pour mieux voir le paysage défiler, et l’air se faisait plus salé à mesure que l’on approchait de la mer. Là-bas, dans une grande maison simple, louée ou prêtée aux œuvres pour la saison, on dormait dans des dortoirs clairs où le soleil entrait tôt par les fenêtres ouvertes. Le matin, c’était la prière au jardin, le gravier encore frais sous les sandales ; l’après-midi, les grandes courses dans les prés, les genoux griffés par les herbes hautes, et les bains surveillés où les cris couvraient le bruit des vagues ; le soir, un chant sous les auvents, la lumière déclinant doucement tandis qu’une odeur de soupe montait de la cuisine.
Beaucoup revenaient changés, plus solides, le visage hâlé, les poches pleines de coquillages, et dans le regard cette confiance neuve qui naît quand on s’est senti aimé loin de chez soi. Les familles donnaient ce qu’elles pouvaient : un panier de légumes, une nappe brodée, quelques draps pliés, ou parfois seulement un merci maladroit, tracé de travers sur une carte. Ce lieu était devenu un horizon que l’on attendait toute l’année, une promesse inscrite dans le calendrier des œuvres, et qui portait les enfants bien au-delà des rues étroites de Championnet.
« Comment meurt un prêtre » – 20 juillet 1911
Ce jeudi 20 juillet 1911, la chaleur d’été s’épaississait jusque dans la sacristie. L’air sentait le bois ciré, mêlé à une pointe d’encens qui traînait encore depuis la messe du matin. Dans son cabinet de travail, l’abbé Garnier était assis face à François Lévêque, professeur de l’école paroissiale. Sur le bureau, la lumière filtrait par la petite fenêtre, découpant des halos sur les piles de papiers et le crucifix accroché au mur.
Depuis des mois, le curé observait cet homme. Les rumeurs étaient devenues trop lourdes pour être ignorées : les violences conjugales étaient connues dans le quartier et alimentaient les conversations à voix basse, et des doutes persistants pesaient sur sa moralité. Déjà, quelques mois plus tôt, il avait songé à le renvoyer, mais la compassion avait retenu son geste : il pensait à sa femme et à ses enfants. Ce jour-là pourtant, la décision était irrévocable. Sa voix resta calme, presque douce, mais chaque mot avait le poids du définitif. « Monsieur Lévêque, vous ne ferez plus partie du personnel enseignant. »
Le silence tomba, lourd, oppressant. On aurait entendu tomber une épingle sur le parquet. Lévêque, blême, plongea la main dans sa veste. En un éclair, le métal froid d’un revolver apparut. Trois détonations claquèrent dans le petit bureau, si fortes que le vitrail de la porte vibra.
La première balle, tirée par derrière, frappa près de la ceinture.
La seconde, en pleine poitrine, lui arracha un souffle rauque.
La troisième s’écrasa contre le bois de la porte dans un bruit sec, laissant une marque sombre.
L’abbé Garnier chancela, s’agrippa un instant au bord du bureau, puis se laissa glisser contre le mur. Ses lèvres murmurèrent aussitôt, haletantes :
– Mon Dieu, mon Dieu, ayez pitié de moi… Je vous demande pardon du fond du cœur de toutes les fautes de ma vie.
Au prêtre accouru :
– Je suis frappé de deux balles… une par derrière, une par devant.
Puis, comme s’il voulait se délester d’un poids :
– Je suis perdu… Je demande pardon à Dieu et à tous mes paroissiens de tout le mal que j’ai pu leur faire… C’est Monsieur Lévêque qui m’a frappé. Je lui pardonne de tout mon cœur.
L’abbé Alix, les yeux brillants d’émotion, se pencha vers lui. Le mourant, lucide jusqu’au bout, lui confia :
– Ne vous tourmentez pas pour l’achèvement de l’église… Les travaux sont assez avancés.
Lorsque le commissaire arriva, le curé, rassemblant ses forces, répéta d’une voix faible mais assurée :
– Tout ce que je puis dire… c’est que je lui pardonne… de tout mon cœur.
Transporté à l’hôpital Bichat, il subit l’examen des chirurgiens. La seconde balle, logée dans le poumon gauche, à quelques millimètres du cœur, ne pouvait être retirée. La respiration était difficile, saccadée.
À 22 h 20, après de longues heures de souffrance, l’abbé Garnier s’éteignit. Le quartier fut frappé comme par un deuil familial. L’Union paroissiale des Hommes lança aussitôt une souscription pour élever dans l’église un monument à sa mémoire. Durant des jours, le cercueil, posé devant l’autel, vit défiler un flot incessant d’habitants. Même les volets des maisons, fermés en signe de respect, semblaient pleurer.
Le 22 janvier 1912, la Cour d’assises de la Seine condamna François Lévêque, né le 29 août 1877, à douze ans de travaux forcés, avec circonstances atténuantes. À la barre, il reconnut que le curé n’avait été ni injurieux ni violent. Mais aucun mot, aucune justification, ne put effacer l’impression terrible laissée ce jour-là dans les rues des Grandes-Carrières.
(D’après L’Écho des Grandes Carrières, 25 juillet 1911)
Bernard et l’élan des œuvres
Dans ce deuil, l’abbé Bernard rassembla les forces vives : on ne laisserait ni les écoles ni le patronage s’effriter. Il s’appuya sur la structure déjà en place de Championnet Sports créée en 1907 pour donner aux activités éducatives et sportives un cadre solide et pérenne. Sous son impulsion, les sections se multiplièrent comme au temps des moissons : gymnastique, jeux d’équipe, sorties, autant d’occasions de former les corps et les cœurs.
L’abbé Alix : tenir dans la tempête
Quelques semaines après le drame, l’abbé Alix fut nommé curé. Silhouette sobre, mise impeccable, il parlait peu mais chaque mot comptait. Il allait rester près de quarante ans à la tête de la paroisse, témoin discret de bouleversements profonds dans le quartier et dans le monde. Sa manière de gouverner n’était pas de s’imposer en maître, mais d’observer longuement, d’écouter, puis de décider avec le calme d’un marin qui ajuste la voile avant un coup de vent.
Dès ses premiers mois, il mesura l’importance des œuvres Championnet, portées à bout de bras par l’abbé Bernard. Il leur donna une large autonomie, laissant à l’abbé Bernard la conduite du patronage, des écoles, des colonies et des sections sportives comme s’il en était le capitaine unique. Naquit ainsi une organisation inhabituelle dans l’Église : un curé et un directeur des œuvres avançant côte à côte, chacun souverain dans son domaine.
L’abbé Bernard, lui, n’était pas homme à rester dans l’ombre. Meneur de terrain, capable de se faire écouter des gamins du patronage comme des notables venus soutenir les œuvres, il passait du banc de touche d’un match de football à son bureau où il organisait une sortie ou rédigeait un rapport pour la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France. Ses colères étaient aussi connues que ses éclats de rire, mais tous savaient qu’il ne laissait jamais un enfant en difficulté.
Entre les deux hommes se tissa un lien solide : à Alix, la stabilité, la vision d’ensemble et la diplomatie avec le diocèse ; à Bernard, l’énergie, l’audace et la proximité avec les familles. Ce partage des rôles, né de l’urgence après la mort de Garnier, devint peu à peu une marque propre à Sainte Geneviève. Certains visiteurs s’en étonnaient : ailleurs, le curé dirigeait tout ; ici, la confiance instaurait une double autorité qui faisait tenir l’ensemble.
1914: Au loin pourtant, des signes discrets troublaient l’horizon. Dans les journaux, les tensions grandissaient ; les lettres venues de province se faisaient plus inquiètes. Alix et Bernard, chacun à leur manière, continuaient de bâtir et d’animer, mais un pressentiment les frôlait : la paix, ici comme ailleurs, tenait à peu de choses.
Chapitre 6 : Quand le fracas du monde s’abat sur Championnet (1914 – 1918)
L’été qui s’assombrit
L’été 1914 avait commencé comme les autres, avec ses jeux bruyants au patronage, les processions qui animaient la rue Championnet et les enfants envoyés en colonie, loin des pavés poussiéreux de Paris. Mais, au cœur du mois d’août, le tocsin résonna dans les clochers du XVIIIᵉ arrondissement : la guerre venait d’éclater. En un instant, la vie de Championnet bascula. Les rires des garçons cédèrent la place aux adieux précipités, les rues se couvrirent d’hommes en uniforme, et les mères, les fiancées, les épouses restèrent seules à prier.
Les prêtres au front, Bernard à l’arrière
Le premier à répondre à l’appel fut le curé Aristide Alix. Incorporé au 8ᵉ régiment d’infanterie, il partit bénir ses paroissiens sous les drapeaux avant de s’illustrer dans les combats, jusqu’à recevoir la Croix de Guerre et la fourragère. À ses côtés, cinq autres prêtres furent mobilisés. Le directeur de l’école et le président des Conférences Saint-Vincent-de-Paul ne revinrent jamais. Seul l’abbé Bernard, réformé, resta au quartier : il devint le pilier de ceux qui n’avaient pas quitté Paris, organisant les œuvres, animant les jeunes et portant avec une énergie infatigable le poids de l’absence des autres.
L’abbé Girouy, héros malgré lui
Parmi ceux qui partirent, l’abbé Girouy, directeur du patronage des garçons depuis 1908, se distingua par un courage hors du commun. Devenu adjudant au 23ᵉ régiment d’infanterie coloniale, il fut blessé à plusieurs reprises, décoré de la Croix de Guerre et cité deux fois pour sa bravoure. Mais la guerre finit par l’emporter : le 11 octobre 1918, il mourut de ses blessures à l’hôpital d’Avize. Ses lettres, lues dans les salles encore imprégnées de sa voix, restèrent comme des fragments de lumière au milieu des ténèbres.
La vie quotidienne dans les Grandes Carrières
Dans le quartier, la guerre imposait sa loi. Le marché Ornano bruissait de nouvelles contradictoires, les tickets de rationnement faisaient patienter des files interminables, et les poêles fumaient faiblement dans les appartements aux vitres gelées. Les femmes tenaient les foyers, cousaient pour les soldats, priaient chaque soir sous les voûtes encore inachevées de l’église. Les jeunes filles trouvèrent au patronage un cercle nouveau où l’on apprenait la couture et la dactylographie, mais aussi où l’on pansait les plaies des âmes inquiètes. Le dispensaire se transforma en ambulance auxiliaire. Les salles de Championnet se firent dépôt de colis et lieu de solidarité, où chaque envoi portait un morceau de la paroisse jusque dans les tranchées.
Un journal comme cordon vital
Le lien le plus fort entre l’arrière et le front fut le petit bulletin Entre-nous, fondé par l’abbé Bernard en 1909. Pendant toute la guerre, il se fit messager d’espoir : on y publiait les lettres des soldats, les noms de ceux qui tombaient, les chroniques que le curé Alix envoyait du front. Chaque mois, ses récits de campagne rappelaient à ceux du quartier que leur pasteur partageait leur sort. Lors d’une permission après l’hécatombe du Chemin des Dames, il reparut à Championnet, portant sa Croix de Guerre au revers de la soutane, et présida les premières communions dans une église pleine de larmes et de fierté mêlées.
Le Ker, refuge et survie
L’année 1918, marquée par les bombardements sur Paris, poussa Championnet à innover. Les enfants les plus fragiles furent envoyés jusqu’à Douarnenez, dans la maison appelée le Ker. Là, au bord de l’Atlantique, ils retrouvèrent un peu de paix, vivant auprès des étudiants parisiens mobilisés comme encadrants. Les plus grands travaillaient aux champs pour aider les familles bretonnes ; le ravitaillement se faisait à pied, parfois à dos d’hommes. Le Ker accueillit même des permissionnaires, offrant pour quelques jours à des soldats harassés le réconfort d’un foyer.
Une église qui se dresse malgré tout
À Paris, les travaux, bien que ralentis, ne s’interrompirent pas complètement. En 1918, l’artiste M. Quelvée commença à sculpter les chapiteaux, et un fidèle offrit un bénitier supplémentaire. Chaque pierre ajoutée, chaque ornement posé prenait alors valeur de défi : bâtir l’église, c’était résister à la folie des armes. Dans le même temps, la Société Immobilière des Grandes Carrières renforçait ses assises : son capital fut augmenté, et le curé Alix y apporta un terrain, le Champ-Marie, reçu en héritage de l’abbé Garnier. Ce geste liait à jamais la mémoire des fondateurs à l’avenir de la paroisse.
Le tribut du sang
Mais aucun travail, aucune fête, aucune prière ne pouvait effacer l’hécatombe. En tout, Championnet paya un lourd tribut. Ils étaient 350 à quitter Championnet pour la guerre, et 87 ne revinrent jamais. À chaque annonce, une famille s’effondrait, des enfants se retrouvaient orphelins, et les femmes du quartier se serraient dans l’église aux voûtes inachevées, suppliant que cesse enfin le carnage. Les cloches sonnaient plus grave qu’autrefois, comme si le métal lui-même s’était alourdi de deuil.
Larmes et espérance
Lorsque l’armistice fut signé, le 11 novembre 1918, les rues de Paris s’emplirent de foules en liesse. Mais dans les Grandes Carrières, la joie était mêlée de larmes. On s’embrassait sur le parvis de Championnet, mais chacun songeait à un frère, un mari, un fils qui ne reviendrait plus. Alors que les cloches résonnaient à toute volée, un silence plus profond habitait les cœurs : celui d’un quartier qui avait tenu bon, d’une paroisse qui avait survécu au fracas du monde, et qui, dans ses blessures, découvrait une force nouvelle. Car malgré les tombes creusées, malgré les absences béantes, l’église se dressait toujours, promesse de vie au milieu des ruines.
Chapitre 7 : Quand les morts veillent, la jeunesse reprend la flamme (1918–1930)
Les cloches de la paix
Novembre 1918, les cloches de Geneviève et Jeanne d’Arc sonnèrent à toute volée. Elles avaient tant sonné pour les départs et les glas qu’on ne les reconnaissait plus, comme si elles s’étaient mises à chanter de joie. Les femmes sortirent des maisons, les enfants coururent dans la rue, les drapeaux s’accrochèrent aux fenêtres. Mais la joie avait un goût mêlé de larmes : 87 noms manquaient, et chaque nom était une chaise vide autour d’une table.
Un curé en soutane sous l’uniforme
Le curé Aristide Alix revint du front, la Croix de Guerre sur sa soutane. Lui qui avait présidé les communions en permission retrouvait sa paroisse. Il avait vu la guerre de près, et cela donnait à sa parole une gravité nouvelle. À ses côtés, d’autres prêtres revinrent : l’abbé Caillet, ordonné en permission en 1916, qui avait servi comme infirmier-brancardier ; l’abbé Couturier, ancien patronné décoré pour sa bravoure, qui deviendrait une figure de Championnet. Beaucoup d’entre eux portaient encore les cicatrices visibles ou invisibles du front.
Un cimetière dans les mémoires
Les noms des morts à la guerre s’inscrivirent sur un mur, puis dans toutes les mémoires. Dans l’église, des messes du souvenir rassemblaient des veuves et des orphelins, les yeux perdus dans les voûtes encore inachevées. On lisait des lettres jaunies, on montrait des portraits en uniforme, on déposait des médailles comme des reliques. Et dans le silence des prières, on sentait que les morts continuaient de veiller.
La jeunesse prend la relève
Les survivants, marqués mais vivants, revinrent avec une fidélité nouvelle. Beaucoup d’anciens du front s’engagèrent dans les œuvres : encadrer les jeunes, transmettre, partager un peu de ce qu’ils avaient appris dans les tranchées. On vit des anciens officiers donner des cours de gymnastique, des médecins enseigner l’hygiène et les premiers soins, des diplômés préparer les jeunes aux examens. Comme si la guerre avait forgé un ciment invisible : « Nous avons tenu ensemble là-bas, nous tiendrons ensemble ici. »
La voix des journaux : « Entre-Nous » et « l’Écho des Grandes Carrières »
Après l’armistice, la paroisse avait besoin de renouer les fils de son histoire, de consoler et de reconstruire. Deux journaux jouèrent alors un rôle essentiel.
Le premier, « Entre-Nous », lancé avant la guerre par l’abbé Bernard, avait accompagné les familles dans l’épreuve : lettres de soldats publiées telles quelles, nouvelles des anciens patronnés partis au front, prières et petites chroniques écrites pour donner du courage. Pendant quatre ans, ce bulletin modeste avait été comme une voix fraternelle, passant de main en main dans les escaliers sombres des immeubles du quartier.
À ses côtés, « l’Écho des Grandes Carrières » prit une dimension plus large. Plus ancien, plus structuré, il devint l’organe vivant de la paroisse et des œuvres. On y trouvait les annonces des messes et des fêtes, les résultats sportifs du patronage, les comptes des souscriptions pour la construction, mais aussi des hommages aux disparus, des nouvelles des colonies et des réflexions spirituelles. Chaque numéro donnait le sentiment que, malgré les blessures de la guerre, la communauté avançait.
Pour beaucoup d’habitants, ces journaux étaient plus qu’un papier imprimé : ils étaient une présence, un signe que la paroisse veillait toujours sur eux. Ils liaient les familles, entretenaient la mémoire des morts, et donnaient à la jeunesse un horizon.
Les colonies et les patronages
Malgré la pauvreté, les colonies reprirent comme un souffle vital. Chaque été, à Saint-Gervais ou au Ker, une centaine d’enfants quittaient Paris, valises bringuebalantes et foulards noués, pour retrouver l’air pur. Les plus grands prêtaient main-forte aux paysans dans les moissons, les plus jeunes découvraient la nage dans une rivière glacée ou levaient les yeux au ciel pour réciter une prière sous les étoiles. Ces séjours étaient plus que des vacances : ils redonnaient à ces gamins du quartier une enfance que la guerre avait volée.
Dans le quartier, les patronages, eux aussi, renaissaient avec une vigueur étonnante. Dès 1919, on y comptait plus de 600 enfants. En quelques années, le chiffre grimpa encore : 800, puis près d’un millier de garçons et de filles franchissant les portes chaque semaine. Dans les classes du catéchisme, plus de 300 enfants reprenaient leurs leçons, entourés d’une trentaine de dames catéchistes, patientes et fidèles.
L’école paroissiale retrouva vite son élan, accueillant 600 élèves, presque autant qu’avant la mobilisation. Et dans la cour, le patronage fourmillait d’activités : théâtre, football, gymnastique, préparation militaire, prières partagées. Les chiffres impressionnaient même les rapports de l’archevêché, qui voyait en Championnet l’une des œuvres les plus vivantes du nord de Paris.
Bientôt, la Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France plaça le nom de Championnet parmi ses sections phares : des centaines de jeunes y apprenaient la discipline par le sport, l’esprit d’équipe par le jeu, et la fraternité par l’effort. On pouvait dire qu’après le fracas des canons, c’était une autre armée qui naissait : une armée de sourires, de chants, de foulards colorés, et d’élans partagés.
Les scouts arrivent, les chemises bleues dans la cour
Au lendemain de la guerre, quand les tambours s’étaient tus et que les rues reprenaient le souffle d’une vie normale, une nouveauté apparut dans la cour du patronage : des garçons en chemises bleues, foulard noué, démarche décidée. C’étaient les premiers scouts de Championnet.
Dans le Paris de l’époque, le scoutisme catholique en était à ses balbutiements. À la paroisse Saint-Honoré d’Eylau, l’abbé Cornette, créateur du FRAT en 1908 organisait les premières troupes. Le père Jacques Sevin, créateur du scoutisme en France en 1920, revenu d’Angleterre, adaptait les méthodes de Baden-Powell à la foi chrétienne. Mais ici, dans les Grandes Carrières, on ne voulait pas seulement suivre : on voulait être parmi les pionniers.
Les garçons de Championnet troquèrent vite leurs habits râpés pour une chemise et un foulard, symbole d’unité et de fraternité. On les vit apprendre à camper, à nouer des cordes, à marcher en file par les sentiers de Saint-Cloud ou de Montmorency. Ils dressaient des tentes avec trois bâtons et un drap, allumaient un feu avec deux pierres, et chantaient à pleins poumons au retour des sorties.
Ici, le scoutisme n’était pas une mode : c’était une suite logique du patronage. On encadrait, on éduquait, on formait des hommes droits et fraternels. Les anciens, revenus du front, trouvaient dans ces troupes un écho de discipline et d’espérance. Et les plus jeunes levaient les yeux, admiratifs, devant ces chefs qui savaient raconter des histoires au coin du feu et tracer un chemin vers l’avenir.
Championnet put ainsi s’enorgueillir d’avoir été parmi les premiers lieux de Paris à mêler patronage et scoutisme, fidèle à son esprit d’initiative. Marie Hirsch, la fille d’Émile, membre fondateur de la Société Immobilière des Grandes Carrières, fut de celles qui soutinrent cette nouveauté. Héritière d’une tradition de générosité, elle encouragea les troupes, contribuant par ses dons à l’achat du matériel et au financement des premières sorties. Elle voyait dans ces chemises bleues un signe que la jeunesse, meurtrie par la guerre, pouvait se relever et construire autre chose.
Et dans les chants du soir, il y avait quelque chose de plus grand que les murs : une promesse de fraternité qui rejoignait celle, plus large, que d’autres paroisses vivaient en même temps, sous l’élan donné par Cornette et Sevin. Mais à Championnet, chacun le savait : cette histoire avait un goût particulier, car elle s’enracinait dans les larmes du quartier et la ténacité des familles.
L’église qui s’embellit, une paroisse debout
Pendant que les enfants riaient dans la cour, l’église continuait de grandir. Les chapiteaux encore bruts furent sculptés peu à peu et chaque pierre semblait polie par la mémoire des absents. La paroisse, encore jeune, prenait peu à peu son allure définitive, à force de patience et de dons modestes.
À la fin des années 1920, malgré les deuils, malgré la crise économique qui frappait les familles ouvrières, Sainte Geneviève des Grandes Carrières était debout. Ses prêtres, ses laïcs, ses jeunes en faisaient un lieu où l’on continuait de croire, de rire, de jouer, d’espérer. On pouvait dire que les morts n’avaient pas donné leur vie en vain : dans chaque cri d’enfant, dans chaque chant de messe, dans chaque ballon lancé au-dessus du patronage, on entendait leur héritage.
À suivre…